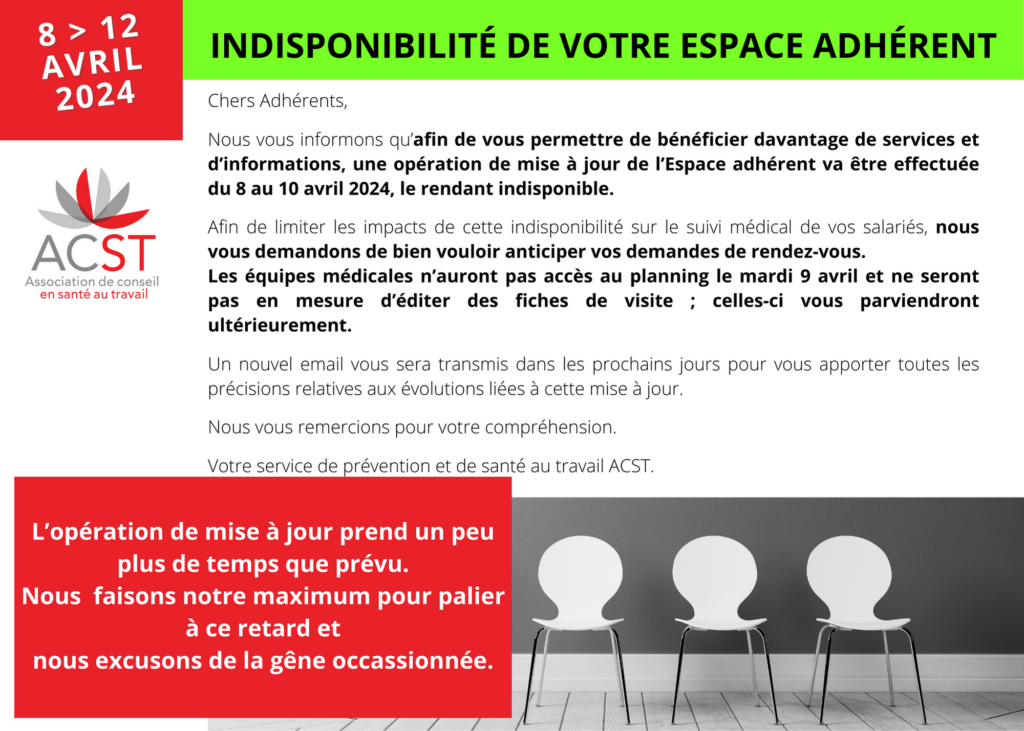
Indisponibilité de votre espace adhérent du 8 au 12 avril 2024
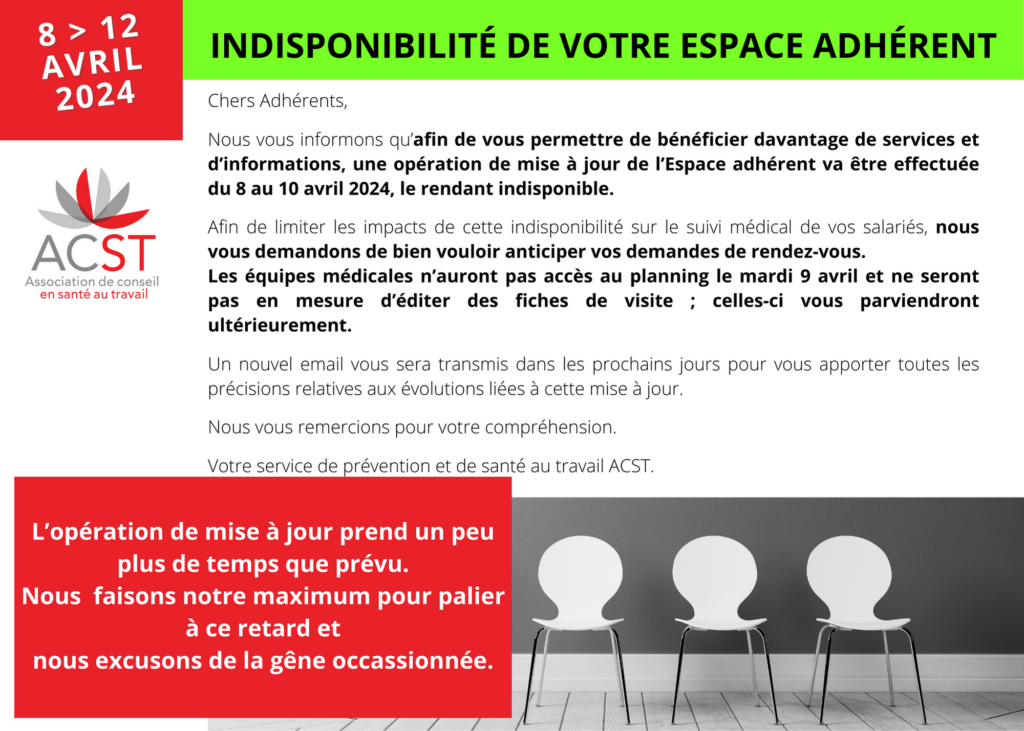

De multiples activités professionnelles nécessitent de travailler dans le froid (entrepôts frigorifiques, chambres froides, travaux en extérieur en hiver…). Il est donc primordial de prendre quelques précautions.
Comme chaque début d’année il est temps de déclarer votre effectif pour l’année 2024 sur votre Espace Adhérent.

En France, 1.1 million de personnes en situation de handicap travaillent, soit 4% des personnes en emploi.1
UN HANDICAP PAS TOUJOURS VISIBLE
Le terme « handicap » regroupe des situations très diverses : troubles sensoriels, cognitifs, psychologiques ou maladies chroniques…
80 % des handicaps sont invisibles !